Massalikul Jinaan ne doit rien « au génie mouride » comme on n’a pu l’entendre – C’est une sémantique qui emprunte tous les codes racistes du culturalisme, surtout dans un pays multiconfessionnel.
La chronique hebdo d’Elgas/Seneplus
Moriba Magassouba a publié en 1985 aux éditions Karthala L’Islam au Sénégal : demain les mollahs ?, ouvrage riche et fondateur dans la lecture du fait religieux au Sénégal. 34 ans après, il persiste et signe. Entretien avec ce Sénégalais qui réside en Côte d’Ivoire, et analyse du roman religieux sénégalais à la lumière des épisodes récents.
La récente inauguration de la mosquée mouride de Dakar Massalikul Jinaan a suscité pléthore d’analyses globalement élogieuses. A les lire, domine en effet un sentiment général de satisfaction, de fierté voire de patriotisme confrérique.
L’impressionnante bâtisse, prouesse architecturale mais surtout symbole de la surpuissance mouride, est devenue dès sa première heure de vie, en étrennant ses atouts, une scène annexe du pouvoir. Un lieu d’irradiation spirituelle si puissant que les querelles politiques domestiques, longtemps explosives, y ont trouvé leur résolution, au prix de quelques accommodements entre le spirituel et le temporal.
Si les tonalités étaient réjouies, la réalisation érigée en symbole d’un « endogénat » émancipé, le discours en surplomb qui a fédéré toutes les analyses a été celui d’une « concorde religieuse » encore à l’œuvre. Jadis, sous le vocable du président Abdoulaye Wade, le phénomène avait pour label le dialogue islamo-chrétien. Bien avant, il a été (et reste) un « roman national », nourri par les têtes de pont religieuses, quelques chercheurs, des leaders d’opinions et des politiques.
Le havre de paix religieuse sénégalais serait épargné par la gangrène régionale, notamment terroriste, grâce au rempart confrérique. Telle était la parole d’évangile. Avec Massalikul Jinaan, le trait confrérique devient même, à entendre certains développements passionnés, le levier économique d’une éthique mouride et d’un esprit du capitalisme pour reprendre le titre de Weber.
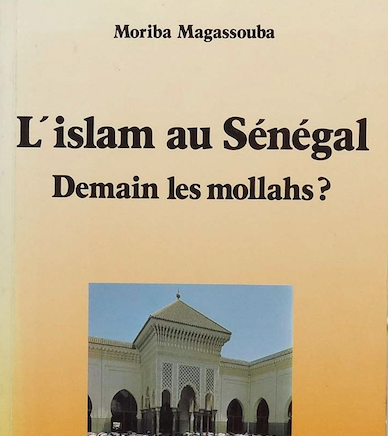
Fond du discours social, sophistiqué par les élites, appuyé par des chercheurs, le roman est devenu la vitrine par laquelle on vend le Sénégal au prix de déformations par trop d’euphorie.
Aux origines du roman national
Pour remonter aux origines de ce « roman national » il faut sans doute aller jusqu’au Sénégal précolonial et aux faits d’armes glorieux des grands marabouts sénégalais, dont le plus important : Cheikh Ahmadou Bamba. L’unicité sénégalaise prend source dans cette histoire précieuse, légendaire, motif de fierté, devenue une base religieuse forte et pérenne.
On pourrait aussi faire appel à un livre, moins laudatif, qui retrace une part de ce roman. Un essai, issu d’un mémoire de DEA soutenu à la Sorbonne, écrit par un jeune homme Moriba Magassouba en 1985 : L’islam au Sénégal, demain les mollahs ?
Après la sécheresse des années 70, avant les ajustements structurels et dans un monde qui a vu l’ayatollah Khomeini arriver au pouvoir en 1979, le livre ne passe pas inaperçu. Son auteur, jeune journaliste à l’affût, est vigilant. Il a un bon flair et ne se défile pas devant les risques que comporte le sujet.
Il connaît la place dakaroise et observe l’arrivée sur la scène de nouvelles idoles religieuses, comme Ahmed Khalifa Niasse, surnommé « l’ayatollah de Kaolack » déjà actif et offensif, avec lequel il s’entretient.
Il se souvient de la naissance de son livre déclenché par plusieurs facteurs : « d’abord l’influence grandissante de l’islam confrérique dans ses échanges avec le pouvoir en place, s’accentuant avec l’arrestation de Mamadou Dia qui avait jusque-là réussi à tenir à distance les marabouts, et l’avènement de Senghor qui a pratiquement formalisé un système d’échanges entre le temporel et le spirituel qui remonte en fait à la période coloniale ».
D’autres facteurs aussi, contextuels et importants à noter, comme les premières pénétrations d’un puritanisme venu du Golfe par exemple « l’arrivée, à pas feutrés, sur ce « marché » porteur de jeunes arabisants formés en Arabie saoudite, en Egypte, au Soudan ou dans les pays du Golfe, et dépeints comme des fondamentalistes ou « intégristes » parce qu’opposés à l’islam soufi confrérique. »
Fruit de recherches universitaires, la thèse du livre décrit les collisions entre le religieux et le politique, l’influence grandissante des confréries, et l’émergence d’un conservatisme d’obédience religieuse, adossé à la lutte contre le style vie à l’occidentale. Sans être réellement de gauche, les groupes islamistes actifs, note Moriba Magassouba, « réclamaient la création d’un Etat islamique. D’où leurs violentes diatribes contre la laïcité, la franc-maçonnerie, les homosexuels, le franc CFA, l’interdiction du port du voile… ».
Comme un calque des épisodes actuels, communs à la France et au Sénégal, on y retrouve toutes les obsessions du conservatisme des mœurs. L’auteur va d’ailleurs plus loin dans son livre en décrivant comment les confréries se sont rendues indispensables dans le jeu politique, jusqu’à devenir des éléments incontournables dans le choix au cœur de la république.
Forme de singularité sénégalaise, la république confrérique, donne lieu très souvent à des critiques variées. D’aucuns en saluent le gage de stabilité, d’autres se désolent du mélange des genres. Sans doute les deux critiques peuvent-elles être recevables.
La politique comme fait social ne peut s’affranchir de ce qui constitue pour beaucoup l’identification première, à savoir la primauté de la foi. Toutefois la république hybride qui en naît ne garantit ni la cohésion, ni l’épanouissement des minorités, ni l’éclosion des droits humains et l’emprise religieux dans ce compromis finit toujours par l’emporter.
Le confrérisme, un islamisme ? Une réception tatillonne du livre
Du reste, l’auteur en pointant les éléments de ce récit national et la réalité des imbrications inopportunes, évoque aussi les influences exogènes avec « l’intrusion des arabisants, notamment les moustarchidins et les wahabias pour ne citer que ceux-là, sur la scène politique, sociale et religieuse avec la construction de mosquées, d’écoles et la fourniture d’aides sociales aux plus défavorisés ».
Cette diplomatie humanitaire « soft » a continué le travail de sape et contribué à installer l’idée de la religion comme solution au tout-social. Avec les échos du puritanisme djihadiste, il apparaît comme un agent possible de la préparation des populations, à la violence religieuse, tout au moins, à un fanatisme mou. Dans l’appréhension sécuritaire des problèmes dits « terroristes », l’évacuation de cette dimension d’assentiment religieux et les causes économiques, sont souvent oubliées.
Il faut noter aussi que ce puritanisme importé (quoique le djihad à son histoire proprement africaine et très ancienne) n’a pas hésité à entrer en frontale opposition avec les confréries qui voyaient leurs parts de marché religieux, menacées par les intrus.
Ainsi se souvient Magassouba que les « intellectuels arabisant constituaient manifestement une certaine gêne pour l’islam confrérique dont ils contestaient jusqu’au mode de désignation des khalifes qui, assurent-ils, est contraire à l’islam des origines où la succession du chef se faisait non pas par la filiation, le sang, mais par la piété, la connaissance des fondamentaux de l’islam, en fait le savoir, et la bonne moralité. Les dignitaires des confréries ont tout de suite perçu le danger qui, comme à Touba, ont même procédé à la fermeture de mosquées tenues par ceux qu’ils qualifiaient d’intégristes. »
Depuis le livre de Moriba Magassouba, les choses ont un peu évolué. L’opposition n’est plus frontale entre importateurs de mosquées et constructeurs confrériques de mosquées.
Les confréries ne semblent plus seulement se construire en écho au fait local, elles s’inféodent de plus en plus au cœur du religieux universel dont les codes conservateurs tendent à s’étendre s’uniformiser. Si les agendas ne sont pas les mêmes, les deux islams paraissent de moins en moins incompatibles, et trouvent dans les piliers religieux, qui demeurent les mêmes, des points de convergence et de communication.
Pour preuve, dans les cités religieuses un puritanisme plus prononcé s’affirme, moins tolérant avec les tenues vestimentaires ou l’alcool, les aspects récréatifs de la vie, imposant ainsi la prééminence de la pureté de la foi sur les coutumes et réalités locales (vous trouverez, de plus longs développements dans Un dieu et des mœurs, 2015).
Le confrérisme est donc un islamisme, d’extraction locale, qui en coche toutes les cases : négation du blasphème, contrôle des tenues, des contenus scolaires, bigoterie, logique de conquête, fanatisation des masse, économie d’inspiration religieuse, élites militantes, violence de la dissidence, anticolonialisme, rejet de la société démocratique et de ses piliers : égalités des sexe, laïcité, etc.
Un livre essentiel et prémonitoire
Pour beaucoup, le livre de Moriba Magassouba a été un déclencheur. Le romancier Ibrahima Hane, auteur d’Errance, roman à la forte connotation religieuse, a d’ailleurs rendu hommage à Moriba Magassouba pour lui avoir servi d’inspiration.
Symbole de la portée de cet essai publié en 1985, le livre jouit de plusieurs recensions dans le monde académique comme précurseur de la première critique articulée d’un fait religieux sénégalais que les africanistes voyaient comme un trait exotique, avec des conclusions ou racistes ou trop emphatiques. Si Vincent Monteil, Donald Cruise O’brien, Sophie Bava, Jean Copans – entre autres – ont fait une ethnographie riche de la confrérie mouride, seul Magassouba a eu un texte offensif, quoique les auteurs cités ont – pour certains – été vilipendés par leurs travaux.
Comment un tel livre a-t-il donc été reçu au Sénégal ? L’auteur raconte : « il a été accueilli avec un certain scepticisme par la presse mais aussi par la grande majorité des intellectuels à la notable exception du professeur Iba Der Thiam, à l’époque ministre de l’Education nationale, si mes souvenirs sont exacts, qui a publiquement déclaré qu’il allait organiser un débat sur l’ouvrage. J’étais évidemment prêt à y participer mais le débat n’eut jamais lieu. Je crois aussi qu’il y a eu quelques velléités de réaction au niveau du Club Nation et Développement présidé à l’époque par Djibo Leyti Ka, mais sans plus. »
Une autre anecdote est plus parlante. L’auteur rencontre le chef de l’Etat d’alors, Abdou Diouf : « lors d’une audience impromptue au Palais. Sans qu’il me l’ait dit ouvertement j’ai eu la nette impression qu’il adhérait quelque peu à la thèse que je développais dans l’ouvrage ».
On pourrait y croire tant l’ancien président est passé maître dans une certaine diplomatie, lui qui, jeune se piquait de philosophie rebelle, et écrivit un mémoire critique sur la foi. Plus récemment, il note aussi : « il y a eu des réactions tardives mais intéressantes comme celle de Madiambal Diagne, le patron de « Le Quotidien », qui a consacré un de ses « Lundis » (éditorial) à mon livre dans lequel il reconnaissait qu’après avoir été quelque peu sceptique à la lecture, il lui semblait aujourd’hui qu’il a été…prémonitoire au constat de la montée de l’intolérance religieuse voire d’une sorte de fanatisme soft ».
Le contexte actuel qui a vu l’extraversion des responsabilités à chaque fait divers est-il pour quelque chose dans la rédemption tardive d’un livre qui paraît, à bien des égards, prophétique ?
L’auteur en tout cas, n’en démord pas. Aurait-il écrit aujourd’hui le même livre ? Il persiste « j’aurais écrit exactement le même ouvrage en pointant précisément la montée de l’intolérance sur la base de faux préceptes religieux, comme cela a été récemment le cas avec l’affaire de l’interdiction du voile au collège Sainte Jeanne d’Arc qui a défrayé la chronique ou celle de la pharmacie Guignon qui a suscité une véritable levée de boucliers sans la moindre raison. Les pouvoirs publics n’ont pas eu, à mon sens, la réaction appropriée contre les dérives langagières suscitées par ce climat d’intolérance qui a même frisé, par moments, la haine religieuse ! ».
On pourrait citer plusieurs évènements qui ont donné à voir la propension à chercher la responsabilité ailleurs. Plusieurs exemples dans divers domaines. Quand le rapport de Human rights watch a dénoncé les abus sexuels en milieu scolaire, les syndicats ont parlé d’intrusion de l’étranger. La même réaction est notée chez les tenants du pouvoir à la suite de l’enquête de la BBC qui ont parlé de tentative de déstabilisation.
Même son de cloche de la part d’ONG musulmanes, comme Jamra, qui fustigent l’importation des tares, au gré des faits divers qui voient des artistes et des séries vilipendés.
Dans tous les segments, semble exister ce déni, dont les conservateurs font leur miel, en étant les instigateurs de ces discours qui prêtent à l’occident des problématiques qui sont le fait de nos sociétés. Toutes les crispations sur fond religieux inquiètent-elles Moriba Magassouba ? Oui semble-t-il « l’extrême frilosité du pouvoir politique qui, soucieux de ne pas déplaire aux chefs religieux et à leurs ouailles, actionne souvent la justice pour des cas qui relèvent le plus souvent de la liberté d’expression. Et cela est extrêmement préoccupant ! »
Dakar, place historique forte des idées
La parole libre de Moriba Magassouba, bien des années après, avec ses mots entre sarcasmes, critique dure et bonhommie, permettent de remonter à un contexte national porteur. Pour celui qui raconte qu’il a écrit une partie de son livre dans un « chai du bordelais » la scène intellectuelle sénégalaise de ces années était dense et vivante.
Sans tomber dans le nostalgisme, il se souvient de cette période qui, « incontestablement, avec le Club Nation et Développement qui organisait régulièrement des débats à la Chambre de commerce de Dakar nous avons connu une période d’une incroyable densité intellectuelle. Par la force des choses, notre capitale était devenue le point de convergence obligé et régulier des têtes pensantes du monde francophone en général et africain en particulier. Feu le professeur Doudou Sine, le sociologue Pathé Diagne, le cinéaste Ousmane Sembène, Babacar Ba alors puissant ministre de l’Economie et des Finances, Alioune Sène « Mendez » le ministre de la Culture, le journaliste Philippe Decraene, Hervé Bourges, Fara Ndiaye, alors numéro 2 et député du PDS, le sociologue Pathé Diagne ou le philosophe Pathé Sémou Guèye étaient les principaux animateurs de cette espèce de brain-trust qui appartient, hélas, à une époque révolue. »
Beaucoup de grands noms de la scène intellectuelle. Une tradition qui perdure selon lui avec notamment un regard très optimiste sur les évènements qui se multiplient dans le continent « Dakar vient de vivre les « Ateliers de la pensée », manifestation qui a vu la participation d’intellectuels de renom comme nos compatriotes Souleymane Bachir Diagne et Felwine Sarr, Achille Mbembé et d’autres sur des thèmes et des questionnements qui nous interpellent tous en ce sens qu’ils devraient, à mon humble avis, tourner autour du combat que nous devons accentuer contre l’inféodation aux puissances extérieures quelles qu’elles soient en traçant la voie d’un développement autocentré. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. »
Un journaliste impétueux à la carrière panafricaine
Qui parle ainsi ? L’homme échappe aux assignations et son parcours parle pour lui. Diplômé en journalisme et en histoire, il a étudié dans plusieurs universités occidentales, en France et au Canada. Sous la houlette de son maître penseur Doudou Sine, il apprend et affûte ses armes : « Doudou Sine, mon prof de philo en terminale à Van Vo, l’un des plus brillants intellectuels africains de sa génération, a été mon maître à penser. Ce marxiste libéral, comme il se définissait lui-même, a joué un rôle prépondérant dans ma formation intellectuelle. C’est lui qui, en orientant mes lectures, m’a fait découvrir des auteurs, penseurs ou hommes de lettres comme Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, Frantz Fanon, Malraux, Gide, entre autres, qui m’ont beaucoup inspiré. J’ai également longtemps côtoyé le sociologue Pathé Diagne, un intellectuel de renom et oncle de Souleymane Bachir Diagne, une véritable encyclopédie vivante, qui m’a beaucoup marqué ».
Il passe ensuite par le journal Le Soleil d’où il est renvoyé « après un mois ». Ensuite Africa international, plus tard Demain l’Afrique avec un proche, Joël Decupper, amoureux du continent où il s’engage. Des mésententes auront raison de leur collaboration.
En 1990 il pose ses valises à Abidjan comme correspondant de Jeune Afrique. Il restera dans la capitale ivoirienne où il se lance dans le consulting avec des clients prestigieux. La terre d’Eburnie devient sa patrie d’adoption.
Ces différentes expériences lui permettent de voyager, d’arpenter le continent de bout en bout, de se faire un carnet d’adresses et d’être aux premières loges pour voir les transformations du à l’œuvre. Il garde un talent de plume, le regard acéré et une écriture parfois railleuse, qui signe une personnalité parfois désinvolte dont la devise est presque philosophique « j’aime l’homme dans tout ce qu’il peut faire de bien ou de mal, car c’est précisément cette dualité, cette ambivalence, qui fait son humanité ! ».
On pourrait croire que l’homme, avec un tel pedigree, n’est pas croyant. Que nenni : « je crois en Dieu et suis même musulman pratiquant mais je pratique l’itjihad ou réflexion critique recommandée même par le saint Coran. J’ai horreur des dogmes quels qu’ils soient et je me refuse à prendre pour argent comptant tous les hadits dont la plupart ne sont que des interprétations et sont donc sujettes à caution. »
Cette sous-région sahélienne justement, qu’il connait bien, est en proie à une déstabilisation à la fois géopolitique et djihadiste avec une gangrène qui se diffuse. Si le récit national continue à évoquer les confréries comme remparts, Moriba Magassouba « craint que non ».
Les remparts sont surévalués. L’exemple du Mali, du Nigéria et du Burkina achèvent de discréditer cette version pourtant complaisamment relayée, devenue un mantra politique et social. Mais il insiste sur une cause essentielle à son avis.
Des foyers djihadistes, dit-il, « persisteront aussi longtemps que les autorités des pays qui les subissent n’auront pas trouvé la réponse appropriée à ce mouvement pour qui l’extrême pauvreté qui frappe les populations constitue le terreau fertile à sa propagation ». Cela rejoint beaucoup d’analyses lucides. Pas étonnant pour ce grand lecteur qui dévore les « thrillers, les biographies », et pour qui « l’homme » reste une passion centrale.
Epilogue du roman national
Le livre de Magassouba a ouvert un champ. Si le fait religieux est resté au niveau national un domaine difficile à étudier sans passions, en sacrifiant comme il se doit à toutes les exigences scientifiques, cela est moins dû à la délicatesse du sujet qu’en l’existence d’une sociologie militante qui est plus dans la réparation d’image que dans l’étude rigoureuse.
Beaucoup de chercheurs sénégalais sont plus préoccupés par l’obsession de « rétablir » l’histoire, moyennant d’autres déformations, que par l’envie de l’écrire comme elle est, dans sa tragique violence, qui égratigne l’image sacrée qu’on se fait de nos saints hommes.
On l’a encore vu dans l’épisode cacophonique de l’histoire nationale pilotée par Iba Der Thiam, l’immixtion des familles religieuses et la prescription de ce qui doit être écrit.
Cette vielle tare hante les sciences sociales sénégalaises, qui peinent à s’élever à hauteur de la science, qui ne doit pas être du marketing religieux, mais plonger dans les faits avec des outils scientifiques, sans arrogance ni soumission, avec la modestie du terrain et la prééminence de ce qu’on y voit sur les tentations idéologiques et partisanes.
L’inauguration de la mosquée de Massalikul Jinaan, a encore pointé cet esprit qui domine, de la démission de toute lucidité pour entonner les chants louangeurs chez les tenanciers du discours intellectuel qui ont pignon sur rue. Cette mosquée ne doit rien « au génie mouride » comme on n’a pu l’entendre.
C’est une sémantique qui emprunte tous les codes racistes du culturalisme, surtout dans un pays multiconfessionnel. Le mouridisme n’est pas le « facteur » important dans l’enrichissement ou dans l’émergence d’une science économique, et ce par la seule preuve que la région du Baol, bastion du mouridisme entre autres, reste l’une des plus pauvres du pays.
Que nous sommes plus ici dans un capitalisme du don, de la privation, de l’obligation, de fortunes importées (souvent de la diaspora), hiérarchiques et verticales. Que partout dans le monde, l’essentiel des mosquées, des petites aux plus grandes, est financé par le don des fidèles ou le don de pays musulmans.
Qu’à supposer que cela marche miraculeusement au nivau national comme modus operandi, ça demanderait comme condition une homogénéité confrérique.
Que nous sommes dans une économie unidirectionnelle qui s’incarne plus dans le symbole de puissance, pour l’instant, que dans la redistribution communautaire égalitaire.
Que nous nous rapprochons presque du capitalisme oligarchique qui consacre la fortune de quelques-uns dans la misère du grand nombre. Beaucoup d’observateurs avaient vu dans l’habileté de la collecte des fonds telle que vue dans la construction de cette mosquée, une promesse. Ils rejoignent la pensée longtemps répandue des transferts d’argents comme solution locale pour le développement : non seulement la zone de production des finances n’est pas endogène, mais le mécanisme du don, sans retour, tend à être un capitalisme sauvage sans égalité, inclusion, et filets sociaux.
Cette mosquée est une belle réussite, sans doute un symbole, un honneur national, elle n’a pas besoin qu’on lui prête des vertus qui ne sont pas le siennes. Saluer une confrérie sans en épouser le fanatisme ni les légendes superflues. C’est le risque avec les romans nationaux, bien souvent il suffit de faire un détour dans les archives historiques, pour séparer le réel de la fiction.
Pour avoir les clefs de cette distinction, Moriba Magassouba n’est pas un prophète de trop. Aujourd’hui les mollahs pourrait-on actualiser son titre, avec moins de motifs d’espoir, car les élites sont devenues la locomotive du conservatisme.




